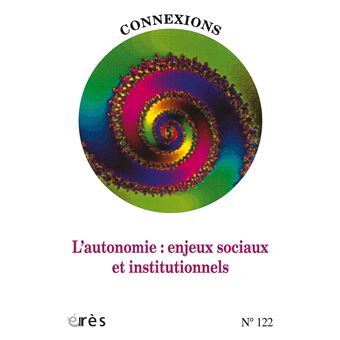
Texte prononcé dans la journée de rentrée du CRPPC, dans un espace table ronde doctorants. L'idée était de présenter des fragments de recherche. Ce texte faisait partie de la section "Recherche qualitative engagée dans un monde de données neutres". Je notais en introduction que, si le thème du "Monstrueux" avait recueilli beaucoup de suffrages, les doctorants ne se bousculaient pas pour entrer dans celui-ci. Et que personne ne voulait évoquer les "terrains abrasifs" convoquant une autobiographie du chercheur en action. Le texte aurait pu être dans les trois cases. Il revient sur quelques communications et articles, dont le plus récent, et peut-être le dernier, car il faudrait de l'argent pour aller plus avant, se trouve dans ce numéro de la revue Connexions. Le propos porte moins sur le fond que sur le positionnement du chercheur.
François Laplantine dans un séminaire sur la pensée métisse avait cette formule saisissante : le chercheur doit rester neutre vis à vis du terrain, mais la limite est peut-être le moment où les cannibales commencent à cuire les missionnaires dans la marmite.
Nos recherches nous éloignent le plus souvent de l’anthropophagie. Je partirai donc d’une forme de prédation contemporaine qui se signale moins par sa crudité que par sa neutralité apparente et des liens entre humain qui sont de l’ordre du branchement et du débranchement machiniques.
Et je vais vous raconter comment, dans cette situation, un chercheur peut interagir violemment avec son terrain de recherche, pratiquer la critique acerbe, l’humour trash, l’insulte, le sabotage, au risque de produire un effacement partiel des données.
Il s'agira de défendre l’hypothèse que cette position n’est pas nécessairement un “dysfonctionnement problématique”, ni un manquement à la déontologie, ni complètement incompatible avec la recherche.
Avec Héloïse Haliday, enseignante chercheuse HDR à Dijon, nous avons investigué des situations de sous-traitance de l’activité de psychologue. Psychothérapie, test psychométrique, analyse institutionnelle, évaluation psychologique avant chirurgie, rien n'y échappe.
Ces offres circulent hors des circuits classiques et situent le psychologue dans des places ambiguës entre situation libérale et subordination salariale. Il est alors dépossédé d’éléments fondamentaux de ce qui fonde sa profession et rabattu sur une place technique limitée.
Ces situations pourtant visibles et répandues semblent échapper à la fois à l’action militante - qui se focalise sur l'État et sur la manne de la formation continue des libéraux - et à la recherche - qui se concentre sur les emblématiques livreurs à vélo. Elles sont banalisées par les pairs.
Le paradoxe étant que cette situation peut sembler au professionnel non seulement normale mais très désirable.
Une sous-traitante en analyse de la pratique avait ce propos typique:
“J’arrive dans le groupe, je me pose, je me branche, je n'ai pas à réfléchir, je me centre sur la clinique. C’est notre cœur de métier quand même.” Elle ajoutait: En plus, l'organisme nous offre des séances de supervision. On n’est pas payés, mais on est libres de venir. C’est vraiment un plus par rapport à d’autres.”
L’exploration préliminaire est passé par la participation observante subie, puis choisie, de ces situations. Elle fut complétée de la lecture des réseaux sociaux où ces offres circulent. L’analyse des résultats s’est pour l’instant borné aux discours "publicitaires" autour de ces situations et des hypothèses inductives sur les processus sous-jacents.
Vous me direz: "Ce n’est pas très clinique, ce n’est pas très recherche, c’est de la politique."
Et il est vrai que j’aurais des difficultés à dire si, vis à vis de ces objets, j’ai d’abord été clinicien, militant, ou chercheur. Mais l’on peut considérer que "le politique", comme surdétermination des conditions dans lesquelles la clinique prend corps, peut constituer un objet de recherche de notre champ et doit être une préoccupation constante du clinicien.
Sur le terrain, j’étais régulièrement traversé par de violents mouvements de révolte que je n’ai pas cherché à réprimer. Je suis donc intervenu avec virulence, dans une alternance entre volonté de comprendre, sentiment que ces situations sont nocives pour la profession, et violence assumée. A visage découvert.
Dès lors, est-ce que la recherche est compromise quand on traite sur un forum ou des réseaux des psychologues de « mères maquerelles qui font la sortie des écoles » ?
Pas nécessairement, si nous considérons les résultats académiques produits, c’est-à-dire, pour revenir à la comptabilité, trois communications (j'inclus celle-ci) et trois articles (un dans une revue de vulgarisation, celui de Connexions, et un autre à venir sur les fragmentations de la profession). Sans doute que j'y reviendrai dans le cas spécifique de l'analyse des pratiques professionnelles.
L’équilibre que nous avons trouvé dans l'écriture à deux, et la solidité de l’arrimage épistémologique et méthodologique de ma collègue, ont peut-être déconfusionné les places du clinicien, du chercheur, du militant.
Et nous pourrions gentiment entretenir le mythe de l'Universitaire raisonnable qui canalise les intuitions empiriques du praticien enragé et le guide vers une saine publication. Mais la co-écriture fut subtile, et le plus neutre vis à vis de ces phénomènes n’était pas nécessairement celui que l’on croit.
Il m’en reste aujourd’hui une question éthique. Qu’est-ce qui est le plus dommageable ? Le simulacre de neutralité qui entoure ces situations de travail ou la violence de l’intervention du chercheur ? Est-ce que c’est plus dangereux de lutter contre son objet de recherche, de l’aimer trop ou de le transformer en produit de consommation ?
Geoffroy de Lagasnerie dans un texte que je cite suivant, son discours d’HDR, nous donne une piste, que Léa [Julian, intervenant sur l'engagement comme méthode dans les études sur le genre] pourra réutiliser en CSI :
“Cette incomplétude du travail théorique ne signifie pas que, sur un domaine précis, dans sa singularité, nous ne pouvons pas tâcher de développer le vocabulaire le plus autonome, le plus pur et le plus frontal possible, le plus maitrisé aussi. En tout cas, il me semble que l’on comprend ici de manière très concrète en quoi une certaine forme d’aspiration à l’oppositionnalité ne vient pas, contrairement à ce qui est parfois avancé, freiner l’ambition scientifique mais la nourrit au contraire et lui donne sa plus grande exigence.”