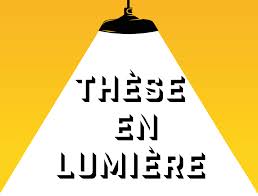
Ce texte est la reprise d'une communication avortée dans une journée jeune docteur. Il a servit de variable d'ajustement dans la compression du temps, mais il mérite d'être repris, au-delà de sa dimension périssable d'actualités. D'une part, parce que les dispositifs vont se poursuivre, d'autre part parce que la question de la vulgarisation scientifique continuera de nous travailler. De manière amusante, plusieurs collègues plus jeunes ont pensé que j'allais parler d'Instagram, qui constitue, comme internet, un point aveugle de mon propos. Il faudrait faire un deuxième épisode. En attendant il est possible de lire ce texte sur l'éthique.
La vulgarisation est un drôle de mot, péjoratif, de ceux qui sont décourageant d'avance. La pratique de la vulgarisation scientifique n'est pas la plus encouragée, nous sommes plus enjoints à publier dans "des revues qui comptent".
Pourtant, publier dans des revues professionnelles, dans Canal Psy, participer à des débats publics, est une manière d’envisager la recherche comme action, comme occupation du terrain, et non pas seulement comme gestion d’une entreprise de cryptomonnaies.
Et ça aide parfois à ne pas tourner en rond, voire à prendre du plaisir. Ces revues autorisent des formes moins normées, et cela fait du bien de délirer un peu ainsi que je l'ai fait pour des articles à venir dans Psychologue et Psychologie et Le journal des Psychologues ou dans un article passé pour In Analysis. La profondeur et l'ambition scientifique ne me semble pas moindre dans ces textes que dans d'autres produits qui respectent les normes.
Généralement on est bien accueilli et les discussions sont riches.
Voici quelques exemples parmi les nombreux qui s’offrent à nous.
Puisque l’on parle de monstres, le service culturel de Lyon 2 organise une semaine pop "Sang pour sang vampire" en novembre. Outre de très grands classiques sur grand écran (de Murnau à Coppola), vous pourrez entendre Christelle Lebon discuter Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant (illustration de cet article) et participer à une table ronde avec d’autres chercheurs sur l’humanité du vampire et sa mythologie.
A la fin du mois de novembre, c’est Anne Lyse Demarchi et Sonia Benzema, une doctorante et une chercheuse associée de Lyon 2, qui discutent How to Have sex sur le thème des violences sexuelles et de la mémoire.
En octobre, nous retrouverons le collectif Ciné Psy Agora dans une intervention croisée avec le Conseil Local de Santé Mental et Le collectif des journées Cinéma et Psychiatrie pour un cross over autour du film Au Clémenceau.
En octobre et décembre, nous présenterons La Chambre d'à coté de Almodovar dans un débat sur la fin de vie, et Sur l'Adamant de Nicolas Philibert, à l'Aquarium Ciné Café, qui fait régulièrement œuvre de vulgarisation à travers le médium du cinéma. La première sera avec une association spécialisée et Cristelle Lebon, le second avec une psychologue stagiaire ayant pratiqué et cherché dans les lieux, et moi (qui ai travaillé 2 ans et demi dans le ventre d'une péniche Accueil de jour).
Pierre Justin Chantepie semble beaucoup investir ces dispositifs. L’année dernière, il présentait dans un film sur l’adolescence, cette année il est intervenu dans les psy Dej en compagnie d’autres enseignants chercheurs. Il lance en librairie avec Svetoslava Urgese un book club psycho-politique.
A la fin du mois de septembre, Julie Francols, ici présente, présentera son travail dans le dispositif Thèse en lumière à la bibliothèque Chevreul. Le 21 octobre, j’y parlerai de l'ambiguïté des dispositifs d’analyse de la pratique en repartant de la base, un texte d'Yves Clot. Il reste de la place pour présenter vos travaux.
Les chantiers de la recherche sur Radio France, vous avez du recevoir le lien, est un autre dispositif.
Il faut encourager les gens à y aller, occuper le terrain. Estelle Veyron La Croix qui a soutenu en janvier et vient de publier dans In Analysis un résumé de thèse marquant, que je résumerais en "stérilisation forcée bienveillante de femmes porteuses de handicap," devrait y prétendre.
C’est un modèle de recherche qualitative engagée. Et pour tout dire, c’est assez frustrant de le ne la découvrir qu’après sa thèse. Nul doute que si nous étions un an plus tôt elle aurait eu sa place avec nous dans la catégorie qui suit sur l’engagement.