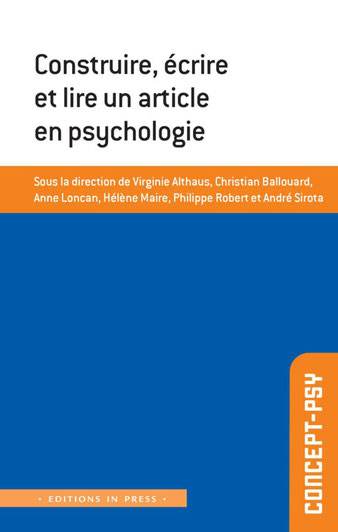
Plusieurs post sur les réseaux sociaux de cette semaine interrogeaient la manière dont on écrit des livres et des articles scientifiques en psychologie.
Il en allait de contraintes internes - se légitimer à produire - et externe - comprendre les logiques et l'économie de l'édition.
Voici en résumé quelques conseils rapidement ramassés.
Je ne suis pas plus légitime que ceux à qui j'adressai ces idées. Pas de livres au compteur - deux chapitres et un projet seulement - et un nombre d'articles scientifiques pas si important.
Néanmoins, j'ai assisté à des écritures chez des collègues, dans des contextes divers (publication de thèse; mise en forme d'un collectif; voisinage d'un auteur qui se lance dans la rédaction d'un livre par an; atelier d'écriture; cours sur l'écriture) et surtout je n'ai rien à vendre.
Cela peut constituer un début.
En exergue de cet article, on trouve un livre très intéressant, qui est moins un guide qu'une carte du paysage.
En préambule, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant:
1) Il est possible d'écrire des livres et des articles scientifiques sans être docteur en psychologie, sans être doctorant, sans avoir fini son cursus professionnel, sans co-signer avec un directeur de thèse.
Pour ne prendre quelque exemples locaux et récents: Camille Casado, Amélie Chaffange, Marinne Favre, ont toutes écrit et publié au cours de leur Master à l'UCLY, des articles très intéressants. Les deux dernières ont été accompagnées dans un dispositif d'écriture, d'où les cosignatures, mais elles ont été motrices.
Avec d'autres étudiantes en Master, nous avons dernièrement proposé à la publication trois articles initiés en cours de formation pour des revues qualifiantes. Ils rendaient compte d'une recherche.
Et ces six exemples n'ont qu'un code postal. Multipliez ça par les autres localités.
2) Tous les textes ne visent pas la longue démonstration, les formats sont pluriels. Il est possible d'écrire sur beaucoup de choses différentes, dans des formes très différentes, dans des épistémologies très différentes. Cas clinique, notes de lecture, analyse d'un dispositif, éditorial, évènements sociaux, institution, réseau, etc. Il est même autorisé de se faire plaisir. Vous avez besoin des revues, les revues ont besoin de vous.
3) Concernant l'écriture, c'est une langue moins poétique que technique qui est attendue, et les capacités littéraires sont presque secondaires. La structure par contre est essentielle, et cela s'apprend plus vite que la poésie.
Livres
1) Premièrement, pour lever les inhibitions internes (de classe sociale, de névrose, de révérence des maîtres), il faudrait procéder à un travail de désacralisation des objets:
2) Il est ainsi plus facile de faire publier un livre qu'un article dans une bonne revue, il suffit pour cela de payer. Raison pour laquelle s'il y a une valeur de prestige, il n'y a pas une grande valeur sur le plan comptable. Problème résolu, donc, sauf si vous voulez publier quelque chose de qualité.
3) Chaque mois sortent des livres inutiles, des articles médiocres, voire honteux. Leur lecture et leur déconstruction rigoureuse vous aidera à vous sentir plus à l'aise avec votre légitimité.
4) Ecrire et publier sont des processus distincts. Il est tout à fait possible d'écrire des choses excellentes qui échappent à la publication et qui peuvent être diffusées par d'autres moyens. Néanmoins le processus d'édition est essentiel dans la qualité d'un livre. Comme la revue par les pairs, le fond et la forme sont souvent améliorés.
5) N'écrire un livre que quand on est sûr qu'il pourra être publié. L'édition est un champ économique fragile, et certains sujets ou traitement des sujets ne sont pas porteurs. Contacter un éditeur avec un pitch, sur la base d'une idée pourrait être une idée pour ne pas s'épuiser en vain.
6) Comme partout votre situation dans un champ intellectuel (titre reconnaissable et élevé) et un réseau (affiliation, reconnaissance, connaissance) peut jouer. Travaillez votre réseau.
7) Il y a malheureusement beaucoup de bons livres qui souffrent d'un travail d'édition insuffisant ou médiocre. Cela empire quand le livre est mauvais et qu'il ne tient pas debout tout seul. Soyez donc exigeant dans le choix de votre éditeur, au risque sinon de publier dans une collection méprisée.
8) Et puis pourquoi écrire un livre ? Est-ce que le monde a vraiment besoin de ça ? Est-ce que les formes fragmentaires et diffuses ne sont pas plus adaptées au monde contemporain ?
9) Approcher. Lire beaucoup, critiquer des livres pour des revues, écrire des chapitres d'ouvrage (par exemple dans des colloques ouvrant à cela) peut contribuer à se familiariser avec un environnement.
10 ) Pourquoi écrire seul ? Avez-vous pensé aux collectifs ? A Deleuze et Guattari ?
Articles
1) Si j'applique l'idée de 1 article = 1 idée, quelle est mon idée/proposition ? Est-elle originale au regard de la littérature ? Quelle est sa portée ? Qu'en disent des pairs qui ne sont pas mes amis ?
2) A qui je veux m'adresser ? Le grand public ? Les pairs ? Les professionnels au sens large ? La communauté scientifique ? Dans quel délai je veux publier mes résultats ? Quel intérêt à publier dans une revue plutôt que sur Internet ?
3) Quel est mon objectif ? Diffuser le savoir ? Progresser dans la chaine alimentaire de l'Université ? Faire de la publicité pour mon activité ? Valider un nouvel outil (Ici: validation d'un outil de soin) ? Avoir un regard des pairs sur mon travail ?
4) En identifiant des mots clés thématiques (ex. jeunes, étudiants), épistémologiques (Psychodynamique) et techniques (thérapie brève), méthodologique (monographie), restreindre le champ des revues (Ex. Peut-être pas La revue française de psychosomatique.)
5) Est-ce que, comme le suppose le point précédent, j'ai fait un balayage des revues possibles sur Cairn et sur Open Editions, puis sur les bases de type Scimago. suppose aussi de savoir dans quelle langue on veut publier: plus de langues ouvrant plus de champs.
6) A l'intérieur de ce champ restreint, quelles sont les revues que "j'aime bien" et qui font de la qualité ? Est-ce qu'elles publient des articles proches du mien ? Est-ce que la forme de mon article correspond à leur forme ? Est-ce que j'ai lu leurs consignes de rédaction ?
7) Est-ce qu'un appel à communication de ces revues ou d'autres revues correspond à mon propos (Voir Calenda, sites des revues, etc.) https://lnkd.in/eSNAXkQA ...)
8) Ne serait-il pas envisageable, avant de publier mon article, de le proposer comme communication dans une journée d'étude ou un colloque ?
9) Est-ce que j'ai envisagé une série de preprint ?
10) En adoptant la norme la plus générique possible (Résumé, mots clés, plan IMRAD), est-ce que j'ai essayé de sonder le secrétariat de rédaction d'une revue avec un pitch de mon article (moins d'une demi page tout compris) pour savoir si cela pourrait correspondre
Et si le premier article est difficile, le second l'est aussi... Après ça va mieux, mais le risque est l'emballement industriel et les facilités.
S'imposer une norme basse (un article par an pour les professionnels) et une norme haute (ce qui est demandé pour ne pas perish et progresser mais pas plus pour les doctorants et les enseignants chercheurs) peut être une idée.
Ecrire tous les jours, quoiqu'il arrive (Antoine Bioy).